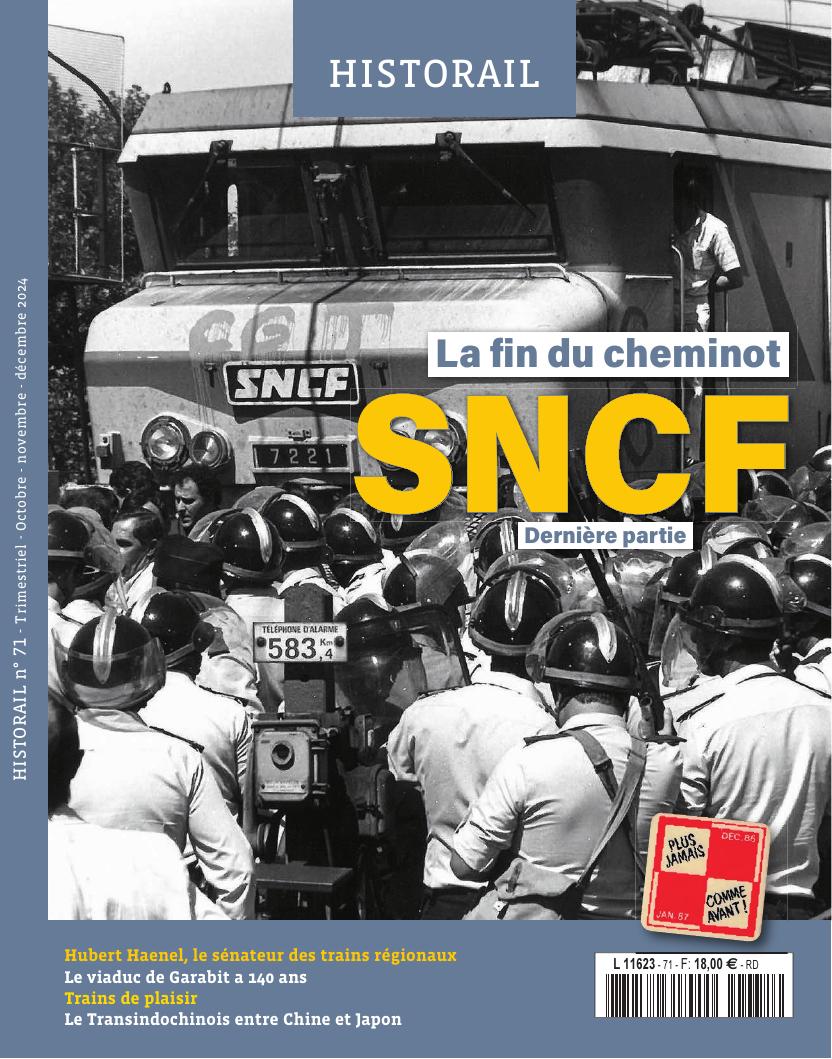En Indochine, le plan d’ensemble des chemins de fer adopté dès 1898 sous l’impulsion de Paul Doumer entendait, d’une part unifier les cinq composantes de la fédération indochinoise, d’autre part capter les échanges commerciaux des provinces chinoises frontalières du Tonkin. En 1937, ces deux objectifs semblent en passe d’être atteints. Le Transindochinois réalise la liaison Hanoi – Saigon à travers le Tonkin, l’Annam et la Cochinchine, tandis que la ligne concédée à la Compagnie française des chemins de fer de l’Indochine et du Yunnan, relie Yunnanfou (Kunming) au port de Haiphong. Pourtant l’affrontement des nationalismes japonais et chinois vient menacer les positions françaises.
La ligne Haiphong – Yunnanfou est construite en 1901-1910, par la Com-pagnie française des chemins de fer de l’Indochine et du Yunnan (CIY), filiale de la Banque de l’Indochine. À l’écartement métrique, elle s’étire sur 859 km dont 465 en territoire chinois. Partie du niveau de la mer, elle s’élève jusqu’à 2 025 m d’altitude, passe 155 tunnels et des ouvrages d’art audacieux dont les plus célèbres sont le pont à arbalétriers et le pont en dentelle. Jusqu’à Laokay, après les rizières, le rail traverse la grande brousse tonkinoise, longeant sur une bonne longueur le fleuve Rouge, entre deux rives resserrées. Après la frontière le rail surplombe des paysages des plus verti- gineux, jusqu’à Yunnanfou, au centre d’un vaste plateau1. Le CIY tire la plus grande par- tie de ses bénéfices du trafic de transit de fret entre le Yunnan et le reste de la Chine. En 1935, par exemple, sur un total de 2,1 millions de piastres ( ), les recettes sont de 102 000 pour les colis postaux et de 1 650 000 pour les marchandises en PV provenant de Chine ou y allant et seulement de 350 000 pour les autres marchandises qui sont surtout des importations du Yunnan (pétrole, essence, ciment, etc.). Le trajet des colis postaux par le CIY, dure de trois à six semaines, à cause de l’obligation d’emprunter la voie maritime de Shanghai à Canton, puis de Canton à Hai- phong. Il s’y ajoute le temps pris à Haiphong pour la vérification en douane rendue néces- saire par l’existence de droits de transit. Dans un rapport au gouverneur général de l’In- dochine (GGI) du 18 mars 1937, l’inspecteur